Raymond Depardon : Pas fait pour le petit écran
Photographe et documentariste du patrimoine, Raymond Depardon, 66 ans, toujours entre deux films, deux expos et deux avions, clôt via le magnifique La Vie Moderne dix ans d’observation du monde rural. Quel est le regard de téléspectateur de ce semeur d’images ?
Dans Standard n°21 – spécial télévision, octobre 2008
Dans la cour d’un immeuble du quartier latin, un pharaon sculpté tient deux amphores. C’est le matin, Raymond Depardon reçoit chez lui – chez eux : nous rencontrons sa première collaboratrice, Claudine Nougaret, ingénieur du son depuis Urgences (1988) et coproductrice dès Afriques, comment ça va avec la douleur (1996) ; son épouse, par ailleurs fan de Radiohead et de Prince. Claudine et Raymond s’envolent demain pour Sao Paulo, elle craint l’enlèvement, il la taquine sur sa peur des fourmis rouges. La table est longue et en bois épais, comme à la campagne, le café vite servi. Depardon a la pudeur des taiseux de son film. On parcoure l’ouvrage La Terre des paysans, réunion de photos des héros de sa trilogie paysanne, parmi lesquelles quelques-unes de ses propres parents. Pendant l’entretien, les coursiers défilent, livrant de nouveaux tirages, de nouveaux plans. Près du canapé, la vieille et grosse télé grise est éteinte.
Regardez-vous la télévision ?
Raymond Depardon : Oui. Faut se tenir au courant des évolutions. J’ai été formé par les agences et il faut regarder beaucoup d’images pour pouvoir en faire. Néanmoins, je regarde surtout de vieux films, trois quatre par mois. Pour quelques euros tu peux prendre le téléphone avec l’ADSL et cinquante chaînes, dont certaines permettant d’assouvir une cinéphilie. Je n’avais jamais vu Les Mines du Roi Salomon [Compton Bennet & Andrew Marton, 1950] par exemple, et en technicolor à 20h30, c’est sublime.
A travers vos reportages frontaux et silencieux comme Reporters ou Faits divers flagrants, reconnaissez-vous une filiation, dans le concept de l’émission Strip-tease ?
Je regarde un peu. Ils tombent sur de bons documents, c’est évident. Le direct a toujours sa force, même au journal télévisé. Un accent régional, une colère – du brut –, c’est toujours formidable par rapport à un texte écrit par un journaliste. Ça montre aussi quelquefois sa limite : on ne sait plus qui filme. Caméra participante ou observante, c’est une réflexion que je me suis faite il y a bien longtemps. Sur le monde rural, j’aurais pu chercher des scènes d’engueulades entre deux paysans ; ça aurait été un peu caricatural. Il faut dire qui on est, on ne peut pas rester protégé, éternellement, derrière son appareil. Sinon on est à la merci de la tricherie, quelque part. Les intellectuels des années 80 ont beaucoup accusés ce cinéma-vérité d’être « faux ». Jean Rouch avait trouvé la bonne réponse : il se servait du cinéma d’observation, par exemple sur un rite, puis il prenait la parole.
Claudine Nougaret : L’œuvre de Raymond est à la fois personnelle et impressionniste. Ces reportages Urgences, Délits flagrants sont des touches, avec un auteur derrière. Strip-tease, c’est intéressant mais j’ai l’impression qu’on va jusqu’au fond de la salle de bains, de la chambre à coucher. Et au bout de trois ou quatre, on a la nausée.
Raymond : Les Américains furent les pionniers du genre, du fait de leur rapport naturel à l’image, dont j’étais jaloux : rien à cacher, aucun regard caméra, alors que les Français se demandent ce qu’en penseront leurs voisins. Je ne pourrais pas faire ce cinéma-là, « piéger » les gens modestes, comme dans Strip-tease, particulièrement les gens du Nord et les Belges, très généreux donc victimes idéales. A chaque fait divers dans la Somme, les gens craquent, du pain béni. Et plus on descend dans le Sud, plus c’est difficile ; dans le Midi, silence total, les gens sont méfiants et vous incitent à foutre le camp. Pareil en Bretagne : ils nous disaient « heureusement que vous n’êtes pas de la télé, on vous aurait dit niet. »
Comment observez-vous l’évolution de la télévision ?
Le service public s’améliore et n’a jamais été aussi bon que maintenant. On l’a vu sur les Jeux Olympiques : les commentaires en voix off ont une certaine liberté, ils ont habillés les compétitions de séquences intermédiaires qui montrent la Chine, tournées et montées sur place. J’ai trouvé que c’était très proche de Godard, de Chris Marker. Finis les hommes-troncs, on voit des Pékinois à vélo, des titres défonçant l’image, marquant les temps, il y a un point de vue. Le Président de la République lui reproche de s’être approché du consommateur, qui ferait mieux d’être un peu citoyen. Il a tort, ils ont fait beaucoup d’efforts et il faut qu’ils continuent. Il manque encore cette réelle démarche de se dégager de l’audimat.
TF1, M6, Canal+ ?
Je regarde. Ils ont encore besoin de se libérer de leurs modèles américains. Pour les informations, les caméras sont de mieux en mieux, mais on dirait qu’ils courent encore derrière le sommaire du Monde ou les nouvelles du journal local ! Je déteste en revanche les émissions de cinéma, toujours axées sur la promo. Je me souviens d’une interview très belle du temps de l’ORTF avec Antonioni, pas très bavard, en présence de Monica Vitti, la présentatrice parlait peu, on sentait pourtant quelque chose.
Raymond Depardon : « Les plus touchants, les plus pathétiques, les plus intéressants, ce sont les taiseux, ceux qui ne parlent pas beaucoup. »
Et la téléréalité, le repli sur l’individu ?
Claudine : Certains proches de nos agriculteurs nous parlaient beaucoup de L’Amour est dans le pré. C’est du sous-Daniel Karlin [documentariste télé passé au cinéma, connu pour ses entretiens proches de la psychanalyse de personnes lambda sur leur quotidien]. Ça fait parler du monde rural, mais il n’y a pas énormément de respect des personnes filmées.
Raymond : Quatre millions de téléspectateurs. J’ai regardé un peu, mais ça ne m’intéresse pas trop.
Vos enfants ont 17 et 21 ans. Des différences entre vos comportements télévisuels ?
Claudine : Je suis assez fascinée. Ils téléchargent de la VOD pour 1,20 euro, en parlent sur Internet, regardent les infos, mais pas la télé, surtout des films, des séries et beaucoup de jeux vidéo. Parallèlement, ils ont accès à un champ musical hallucinant, que nous, nous avons mis des années à construire ; ils ont intégré notre discothèque et la leur. L’acuité sonore et visuelle du spectateur d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’hier.
Raymond : Parce qu’on est membres des Césars, on reçoit aussi en DVD la centaine de films nommés. Il y a quatre-cinq ans, ils se jetaient dessus, maintenant ils les laissent traîner. Le format est déjà dépassé, l’objet disparaît.
Et la télé en tant qu’invité ?
Raymond : Je dois passer dans l’émission de Frédéric Taddéi pour La Vie Moderne. J’aime pas trop ça, les talk-shows. Le Cercle de Minuit avec Laure Adler, plusieurs fois, c’était bien. Chez Pivot, je n’ai jamais pu en placer une. Je suis pas très à l’aise, je n’arrive pas à me lâcher. Plus à la radio. Sur la photo, Cartier-Bresson n’étant plus là, ils leur manquent un point de vue de cinéaste, une échelle humaine, et j’en suis une – a priori.
En bouclant cette trilogie sur le monde paysan entamée en 2001, avez-vous l’impression d’avoir réglé votre « dette » envers votre milieu d’origine ?
A priori. C’était difficile. J’avais un problème de mémoire : j’ai commencé par les choses que j’avais peur d’oublier, via un récit de l’enfance [le livre La Ferme du Garet]. Puis des rencontres forcées, des commandes pour Le Pèlerin et Libération m’ont redonné le déclic de retravailler sur ce sujet-là. Un voyage aux Etats-Unis a aussi été très important : les directeurs artistiques de Life et du New York Times me disaient de continuer. Vu de New York, la France est un pays d’origine rurale. Nos Indiens à nous, la presse en parle un peu – la télé aussi, avec un certain folklore, au journal de 13h.
Raymond Depardon : « Les plus touchants, les plus pathétiques, les plus intéressants, ce sont les taiseux, ceux qui ne parlent pas beaucoup. »
Comment se positionner par rapport aux images habituelles du monde agricole ?
Claudine : France 3 est une grande référence pour nous – je rigole.
Raymond : L’objectif était de laisser une trace de dix ans sur l’agriculture française de moyenne montagne. Les gens les plus touchants, les plus pathétiques, les plus intéressants, ce sont les taiseux, qui ne parlent pas beaucoup. Leur silence a une puissance proche, quelquefois, de quelque chose qu’on connaît en théâtre ou en littérature, d’une « résistance à sortir » dont Deleuze dit qu’elle est très cinématographique – alors qu’un débit plus rapide ressemble davantage à de la télé. Je ne suis pas fait pour le petit écran. Sur grand écran, la perception est meilleure, on a du temps, une dimension. C’est comme en photo : plus elle est agrandie, plus elle doit être bonne.
Claudine : Les télés restent sur des thématiques, des mots-clés. Les chaînes décident d’une soirée sur le téléphone portable ou la cueillette des fraises, on a trois vingt-six minutes et l’auteur s’efface derrière l’impératif d’information, façon Envoyé Spécial. Notre grande liberté par rapport à elles, c’est le droit ne pas être exhaustif, et le point de vue de l’auteur. Mais le cinéma d’auteur documentaire audiovisuel a perdu des galons.
Raymond : Et encore, Envoyé Spécial, c’est du luxe. Trois semaines pour réfléchir au sujet et approcher les gens, trois semaines de tournage, trois semaines de montage.
Dans votre livre Errance, vous dites : « La télévision nous donne tellement d’êtres humains, mais c’est son rôle, et je comprends bien qu’elle ne peut pas montrer un écran vide, du temps. Elle se substitue à la photographie d’une certaine manière, qui la débarrasse et c’est peut-être une chance, de la nécessité de s’approcher, d’être toujours sur les visages. »
Oui. Laissons la télévision s’occuper de tout ce qui est portraits, situations. On est obsédé par l’humain ; toujours, toujours, la peur du vide. Les photographes devraient se reculer, prendre de la distance, ne pas systématiquement mettre de l’humain dans la photo. Actuellement je parcours toute la France avec mon camping-car, c’est une mission que je me suis donné : je photographie en couleurs, j’ai fait beaucoup les frontières, le Nord, l’Alsace, la Franche-Comté, les Alpes-Maritimes, le Languedoc-Roussillon et le Poitou-Charentes, il me manque encore le littoral breton, normand, une partie du Centre et le bas du Sud-ouest. Et le boulanger devant sa boutique, on se laisse l’imaginer. Ce qui est important, c’est de voir comment sont installés ces gens, comment s’installe notre territoire. C’est la France d’aujourd’hui, normale, des petites villes ; les grandes n’ont pas besoin de moi. On aura assez de trace de nos êtres humains : les journaux locaux en sont remplis, la télé régionale est assez présente. En revanche, j’avais l’impression que personne ne photographiait la sandwicherie qui vient de se monter, la boucherie qui pourrait partir. C’est étrange, cette relation avec notre territoire.
Y a-t-il encore des gens que vous aimeriez photographier ?
C’est toujours lié à des gens : quand je vais au désert, j’aime la population – peut-être par timidité –, la palmeraie, les dunes, les chameaux, la façon de vivre, quelque part la modernité de n’attendre plus rien de nous, cette résilience de ne pas consommer des choses inutiles. Ces images qui les présentent comme les derniers hommes libres, heureux, ce n’est pas vrai, et dangereux. Chacun sa croix à porter : moi je crois qu’il a des gens qu’il faut défendre plus rapidement que d’autres, en trouvant, c’est toujours la question, la bonne distance.
Prochains voyages ?
J’ai la France à finir, et on lance un autre tournage, l’année prochaine, sur le voyage en camping-car, sur mon passé, une espèce d’autofiction, voilà.
La Vie Moderne
La Terre des paysans (Le Seuil)
L’expo
« Ces gens qui disparaissent »
Hyperactif, Depardon participe en novembre à l’installation Terre natale. Making-of.
« Avec certains chercheurs, Paul Virilio [philosophe et urbaniste] travaille sur des architectes américains, le numérique, Internet, c’est très ludique. Avec Claudine, à travers des movement pictures sur trois écrans, et surtout du son, on rencontre des gens menacés (un peu) et leurs rapports à leurs vies, leurs territoires. Au rez-de-chaussée, un premier volet traitera des langues maternelles. On reconstituera de manière très forte la Bretagne, mieux qu’au cinéma. J’ai fait les Occitans, aussi. On part en Amazonie demain, filmer les Indiens Guaranis qui ont transposé la forêt dans des banlieues, et qui conservent leurs coutumes sans se mêler aux Blancs. Puis on va chez les Yanomamis vivants sur des territoires très riches (en pétrole, diamants, bois précieux), à cheval sur le Venezuela. La société veut les intégrer, mais s’ils acceptent, ils seront clochardisés – plus de trente mille êtres. Ce sont eux qui supportent le plus les changements climatiques, qui dérouillent à cause des tempêtes, des tsunamis. On est tous un peu responsables, pas seulement les pollueurs. Ces gens qui disparaissent, je trouve ça très émouvant. »Terre Natale – ailleurs commence ici, du 21 novembre au 15 mars 2008. Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail, 75014 Paris.

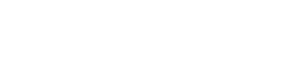













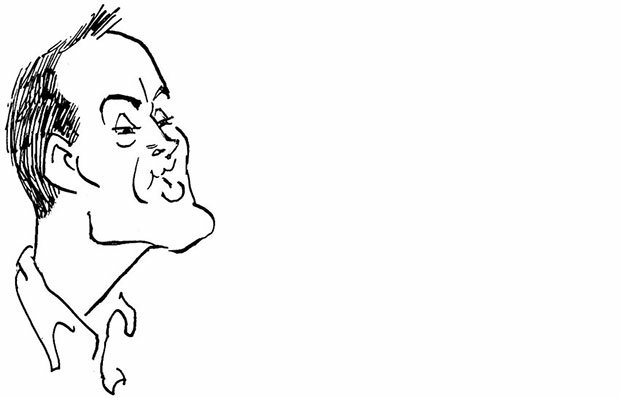






































 TUMBLR
TUMBLR


