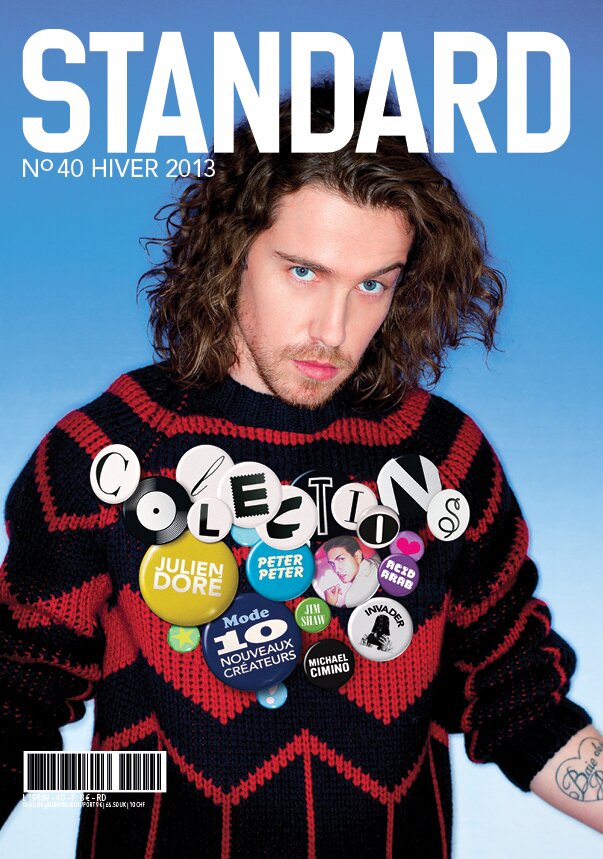Le chorégraphe et créateur de costume français Christian Rizzo investit la scène de vêtements flottants sans danseur, de costumes entravant les mouvements, de corps fragiles comme des chrysalides… Des monstres de mode ? Retour sur un parcours sensible et transversal qui s’épanouit dans les marges.
En lisse pour la direction du Centre Chorégraphique de Roubaix, le chorégraphe et créateur de costume français Christian Rizzo, 47 ans – Toutes sortes de déserts lors du Festival d’automne à Paris en 2007, Mon amour pour l’Opéra de Lille en 2008, Ni cap, ni Grand Canyon pour le Ballet de l’Opéra de Lyon en 2009 –, interviendra au Festival d’Avignon cet été pour y présenter sa nouvelle création D’après une histoire vraie, du 7 au 15 juillet. Par l’importance toute particulière que cet ancien styliste accorde aux vêtements, sa danse s’élance, échappés et entrechats, vers la mode.
Vous avez été formé aux arts plastiques à la Villa Arson, à la musique en montant un groupe de rock… comment êtes-vous arrivés à la danse ?
Christian Rizzo : Ado dans les années 80, on avait le choix entre le foot et un joyeux merdier où se croisaient la créatrice de lingerie Fifi Chachnil qui jouait dans les Lucrate Milk (groupe alternatif de la mouvance post-punk), des collectifs d’art urbain comme Les Musulmans Fumants et les Rita Mitsouko. Je faisais partie de la clique de Toulouse avec le performeur La Bourette ou la créatrice Nathalie Elharrar et nous avions un objectif : créer ce que Marie Rucki avait inventé avec le Studio Berçot, une école où notre avenir se jouerait aux croisements de la mode, de l’art et du rock. Quand je suis arrivé à la Villa Arson en 1985, je me suis aperçu que le milieu de l’art ne m’intéressait pas. J’ai commencé à zoner du côté de Jean Paul Gaultier et Jean-Charles de Castelbajac. J’ai été déçu car je me suis rendu compte que la mode était une industrie alors que je la considérais naïvement en lien direct avec l’expression politique. J’avais en tête les Britanniques Body Map ou Katherine Hamnett qui concevaient leurs vêtements comme des supports à imprimer des slogans. J’ai rejoint la danse très tard, à la fin des années 80, par hasard, au travers de la vie nocturne, dans des clubs comme le Palace, le Rex, et puis l’arrivée des Pyramides [soirées clubbing organisées à Paris par le membres du groupe britannique de S-Express]. La mode, la danse, tout se faisait la nuit.
Est-ce finalement malgré vous que vous êtes affilié à la danse ?
Je n’avais effectivement pas cette formation au départ. Au moment où j’ai abordé la danse, je ne l’ai pas prise comme une pratique, mais comme un espace. J’y ai retrouvé les éléments dans lesquels je me reconnaissais : le rapport à la surface, la temporalité, la musique, la lumière, les vêtements, les mouvements, et surtout, la construction de l’imaginaire. Je ne me suis pas dit que j’étais en train de faire de la danse mais que mon travail consistait en une écriture scénique où toutes ces composantes venaient alimenter une partition globale. Aujourd’hui, je suis totalement pris dans ce champ avec des subventions attitrées, mais je continue à avoir un regard oblique. Les questions qui m’intéressent sont les mêmes que pour des films ou une exposition. Mon travail est transversal, créant une singularité que j’ai eu beaucoup de difficultés à faire comprendre.
Comment s’institue la corrélation entre mode et danse ?
Les collaborations entre le chorégraphe Michael Clark et l’artiste Leigh Bowery au début des années 80 posent une certaine forme de postulat. Tout comme le travail du designer Stephen Sprouse avec des chorégraphes américains… Du courant ultra-performatif comme le body-art des années 70, découle une tendance à se déguiser, à faire la « fiesta » qui, dans les années 80, pose le vêtement au-dessus du corps. C’est peut être à travers cette forme de superficialité que le vrai croisement s’opère.
Christian Rizzo : « J’ai été déçu car je me suis rendu compte que la mode était une industrie alors que je la considérais naïvement en lien direct avec l’expression politique. »
Quelle est la frontière entre mode et costume dans une création chorégraphique ?
A partir du moment où la mode entre dans un théâtre, elle est costume. Un aspirateur chez Darty n’a pas le même statut qu’un autre à Beaubourg. Un vêtement n’est plus mode à partir du moment où il est isolé du contexte global de la mode.
Comprenez-vous que votre univers puisse être perçu comme étant de sensibilité « mode » ?
Comme il peut être rock ou littéraire… Il est nourri de mais il ne fabrique pas. Je rapproche cela du travail du DJ, je mixe des entités afin d’en faire un être hybride, rejoignant cette question très présente dans les années 90 autour de la représentation du corps hybridé dans le champs de l’art contemporain. L’important est d’où c’est réfléchi et d’où c’est observé. En voyant certaines de mes créations, des gens me disent que ce n’est pas de la danse. Ma première pièce par exemple. Les vêtements traversaient un espace grâce à un système de ventilation – il n’y avait pas de danseur. Mon discours n’avait pas pour autant trait à la mode, mais me permettait de poser la question de l’apparition et la disparition du corps. Par contre, il est vrai que mon utilisation régulière du vêtement a fini par susciter l’intérêt de maisons comme Hermès [scénographie de l'exposition Le Cas du Sac en 2004 au Musée des Arts Décoratifs] ou de couturier comme Christian Lacroix [il réalise les scénographies de leur exposition en 2004 et 2007 au Festival de Hyères].
Aujourd’hui, vous collaborez avec Walter Van Beirendonck, Bernhard Willhelm ou encore Jean-Paul Lespagnard…
C’est une famille incluse dans la mode mais relativement en décalage avec le système, en marge. J’aime beaucoup les marges. C’est là qu’apparaissent les plus fortes porosités et où se fabriquent les choses. Sans vouloir paraphraser Godard : « Ce qui rentre très bien dans un cadre, ce sont les marges pour pouvoir faire d’autres cadres. »
Christian Rizzo : « J’ai pelé mes silhouettes comme un oignon, à la recherche de ce matériau qui habite le costume. »
Romain Kremer, avec qui vous avez aussi collaboré, explique qu’il aurait pu être danseur mais qu’il a choisi la mode car c’est un domaine où « l’on parle de soi, mais pour les autres, alors que la danse est un rapport narcissique avec son corps ». Qu’en pensez-vous ?
C’est vrai que, pendant la phase d’apprentissage, le rapport du danseur au miroir est traditionnellement très fort, le poussant à rentrer dans quelque chose de narcissique. Et au moment où il ira sur scène, il considérera celui qui le regarde comme le substitut de ce miroir. J’ai un rapport très différent. Dans mes chorégraphies, on accepte d’abord d’être observé plutôt que de se montrer. On ne fait jamais face au public. Parfois, mes danseurs sont de dos, la tête recouverte, alors pour le narcissisme, on repassera…
Le vêtement influence-t-il la gestuelle ou bien s’adapte-t-il à la chorégraphie ?
Pendant longtemps le costume a imposé une physicalité, quelque chose d’énorme et complexe qui entravait le mouvement. Il fallait trouver une danse qui s’adaptait à lui. Au fil de ma carrière, mon processus de travail a changé. J’ai pelé mes silhouettes comme un oignon, à la recherche de ce matériau qui habite le costume. Et j’ai découvert un être fragile, comme sorti d’une chrysalide qui se serait constituée pendant des années [sa compagnie, créée en 1997, s’appelle Association fragile]. Aujourd’hui le vêtement doit respecter le travail du corps car cette fragilité physique ne peut me permettre de la contraindre à nouveau, elle doit se manifester comme telle.
Retrouvez cet article sur le site de la Gaîté Lyrique