Les mille vies de Jacques Chancel : Asie soit-il
Mathusalem de l’audiovisuel, Jacques Chancel, disparu à 86 ans, a vécu mille vies. La première, initiatique, nous intéresse : le « périlleux apprentissage », dans l’Indochine de 1948 à 1958, d’un correspondant de guerre de 19 ans, bombardé parmi les mines, les livres, l’opium et – oh – un éléphant.
Sa première petite-fille, dont il nous présente le berceau, s’appelle Philippine. Comme un clin d’œil à l’archipel voisin de cette mythique Indochine où l’interviewer poli de Radioscopie (1968-1988) et du Grand Echiquier (1972-1983), co-fondateur d’Antenne 2, inaugura sa vie d’adulte. Dans le petit bureau d’un vaste appartement, ne coupant que le son de la télévision diffusant du football africain, Chancel évoque son aurore dans l’horreur – le paradoxe d’une seconde naissance dont il fera, un jour, un livre.
« Je voulais comprendre la saloperie de la guerre, comment les bons peuvent être minables et comment dans les salauds, quelquefois, il y a des pépites de fabuleuse moralité. J’aurais pu m’effondrer s’il n’y avait eu ce copain, un jeune médecin, qui m’a averti du mauvais départ que je prenais. Pendant trois mois, « pour faire bien », avant le café, je m’étais mis au « perroquet ». Trois pastis-menthe chaque matin. Ça faisait mec engagé dans l’aventure – affreux. Puis il y avait les sorties : on allait dans les fumeries d’opium comme on va dans les boîtes aujourd’hui. Au début, je me suis laissé aller pour connaître. L’ambiance était formidable : beau décor, velours rouges, les tapis, ces femmes sublimes, pour la plupart des métisses d’Anglais et de Chinois de Hong-Kong. C’est dans la fumerie de la mère Choum que se tramaient tous les complots, que se rencontraient les officiers viets et français pour arranger certaines situations. De ses années pleines, j’ai compris beaucoup de choses. Je l’avais noté dans un carnet, en 1955 : “J’ai tout vu, j’ai tout connu, j’ai tout souffert. Ce matin, vaniteusement, je me persuade que mon existence est finie : j’ai 24 ans.” »
« Ces dix années m’ont fabriqué. Ma famille était très impliquée dans les affaires de l’Extrême-Orient. Ma tante et marraine était proviseur du lycée Chasseloup-Laubat, un lycée français de Saïgon, et mon oncle, inspecteur général des forêts d’Indochine avec le titre de gouverneur. Ils ont passé cinquante ans sur place, je n’entendais parler que de ça. Ça me permettait d’être zazou : ils rapportaient des chaussures à semelles de crêpe, énormes ! Puis j’ai lu Les Trois Mousquetaires. La France, l’évasion ! Je pensais à D’Artagnan quittant notre bonne province du Gers – je suis né tout près de son assez minable petit château. Lui, a osé partir. Puis j’ai découvert Rubempré [Illusions Perdues] et Rastignac [Le Père Goriot]. Ce n’était pas la célébrité ou le pouvoir : je voulais mener une aventure. Je n’ai rêvé que de ça. J’avais 17 ans quand j’en ai parlé à mon oncle. J’ai fait l’Ecole militaire des transmissions de Montargis, auxquelles je ne comprenais rien. Ma mère ne voulait pas d’un départ précipité, mon père n’était pas content mais… “S’il veut vraiment s’exprimer…“ ».

Jacques Chancel : « J’avais cette curiosité de môme, j’engrangeais, boulimique, sans objectif. »
En arrivant, William Baze, le président eurasien, celui qui apprit à l’Empereur viêtnamien Bao Daï à chasser le tigre et l’éléphant, m’a pris sous sa coupe. Baze avait une plantation de xuan loc [du caoutchouc] et une éléphanterie d’une centaine de têtes. J’ai pris la chambre de sa fille, ma copine, qui, elle, partait à Paris. Et j’ai hérité, en même temps, de deux gibbons, un noir, l’autre, blanc. Le soir, quand je rentrais, ils passaient par les toits pour venir me chercher. Plus tard, j’ai eu « Niok », un petit éléphant de deux mois au destin terrible : on a fait un film sur lui, c’est devenu une vedette, il a fait le voyage jusqu’à Paris, les cocktails, on le promenait partout, c’était très chic, puis il a maigri. Il est mort six mois après. »
« J’ai d’abord été grièvement blessé. J’ai sauté sur une mine – c’est le livre que j’écrirai peut-être cet été. A 18 ans, j’étais à la fac de droit et j’avais une heure et demie d’émission avec une fille, Marina, une quotidienne de musique et de chansons sur Radio France-Asie. Ça s’appelait Jacques et Marina. J’étais heureusement condamné à dévorer la presse qui arrivait de France avec beaucoup de retard. Ça a duré jusqu’à Diên Biên Phû [1954], la grande explosion après laquelle j’ai collaboré à des journaux, je rendais des papiers sur le Tonkin. J’étais toujours étudiant, je lisais les grands classiques : Balzac, Zola, Chateaubriand, Dostoïevski, Tolstoï, les nouvelles de Maupassant. En face de l’hôtel Continental, lieu de tous les complots et de tous les bonheurs, il y avait une librairie pleine du matin au soir, pour oublier l’horreur. Ça canardait toutes les nuits. Lorsque le soir on rigolait, on entendait les bombes à quelques kilomètres. Ceux qui dansaient partaient le lendemain se faire tuer. Toutes les guerres provoquent cette ébullition. »
« Puis j’ai rencontré Raymond Cartier, la grande plume de Match. Ça a été ma chance. J’avais écrit deux romans, L’Eurasienne [1950] et Mes Rebelles [1953]. L’écriture me sauvait de la folie des boîtes et de l’opium. Lucien Bodard, correspondant pour France-Soir et auteur de La Guerre d’Indochine, faisait de grands articles sur moi qui disaient : “Chancel, il connaît aussi bien l’Empereur, les généraux, les putes et les salauds.” J’avais cette curiosité de môme, j’engrangeais, boulimique, sans objectif. Voyant ma folie – je l’ai entraîné pendant trois jours sur toutes les routes de Cholon, l’enfer du jeu à dix kilomètres de Saïgon, trente mille personnes qui jouent en même temps à des trucs tout à fait insensés, au Grand Monde, un bordel géant doté d’un orchestre de dix musiciens – il m’a désigné correspondant de Paris-Match pour tout le Sud-Est asiatique, rattaché à la Légion étrangère. Ma règle, c’est de dire la vérité, mais la censure, là-bas, préservait de la mort. J’apprenais de Bodard, de Jean Lartéguy, de Graham Greene. Ils avaient vingt ans de plus, j’étais le bébé, je n’avais pas de certitudes, je creusais tout ce que j’entendais. »
Jacques Chancel : « Je suis un peu Asiate, moi. »
« Je ne travaillais que pour Match, parfois un papier par semaine, parfois des photos : un jour, sur la terrasse en flammes d’un grand restaurant, j’ai photographié toutes les chaises renversées avec une pauvre femme accroupie, qui pleurait. Double-page dans Match, la photo passa dans le monde entier ! [Il rit] Le hasard ! Généralement je faisais de longues légendes des photos et des événements. Je ne me prenais pas pour un immense journaliste donnant ses lueurs sur la guerre. J’étais un témoin, un observateur, j’apportais les nouvelles. Pour vous dire à quel point j’étais gamin : un jour, je rentre de l’ancien palais des empereurs et je vois, dans la rue, une dizaine de cadaves et des gardes en armes dans les tranchées. Quelque chose se prépare. J’arrive à l’hôtel Continental où je retrouve Lucien Bodard pour déjeuner, comme tous les jours depuis trois ans. Je lui raconte. Le lendemain, billet de mon rédacteur en chef : “Plutôt que de faire les folles nuits de Saïgon, il serait convenable de nous dire ce qu’il se passe.” Il ne s’était rien passé : des morts comme ça, c’était tous les jours. Mais France-Soir titrait : « Le sang coule à Saïgon ». Cinq colonnes à la Une ! Bodard s’était rencardé avec les services secrets en partant de mon intuition. Huit jours après, quinze mille morts. Le journalisme, c’était prévoir. »
« Si j’étais amoureux ? Non, à cet âge-là, on court toutes les montures. Si : il y a une femme que j’ai beaucoup aimé et qui, hélas, est morte une nuit de beuverie. A 19 ans. Tuée par des imbéciles qui jouaient avec des revolvers. Je n’y étais pas, mais je suis allé la reconnaître à la morgue. Une Eurasienne d’une beauté extraordinaire, que j’aimais comme on aime à cet âge. »
« Je pars un an après la fin de la guerre. Je passe six mois au Cambodge, à la frontière chinoise, dans un rendez-vous de chasse. Le paradis des tigres, des éléphants, des buffles sauvages de plus de deux tonnes. Mais il fallait rentrer. Tout ça je l’ai vécu bellement et dangereusement. Il y a un endroit, au Nord du Viêt Nam, dont tout le monde parle : la baie d’Ha-Long, une merveille. Pour moi, c’est d’abord un cimetière : une dizaine de mes amis, vingt ans à l’époque, auxquels on prédisait des avenirs fabuleux, y sont enterrés. Vous ne pouvez pas savoir le calme de cette baie… la sérénité dans la mort. J’avais l’inconscience d’un jeune homme. »
« J’ai fréquenté les grandeurs et les bas-fonds. C’est une époque un peu insensée, de presque aventurier. Ce qui m’importait, c’était de vivre chaque minute – aujourd’hui encore ! On en parle souvent avec [Bernard] Pivot : tout ce qu’il nous est arrivé, c’est par hasard. J’étais écrivain, je suis devenu journaliste, homme de radio, homme de télé. Je n’aurais jamais cru. Les choses se sont improvisées. C’est venu de l’appétance que j’avais pour la littérature et la musique – Wagner, Mozart, ça me transportait. Je me félicite d’avoir connu tout ça. On est tous condamnés à mourir, mais il y en a si peu qui auront vécu. »
Entretien Richard Gaitet Photographies Caroline de Greef dans Standard n° 19
Les Années turbulentes, 2005-2007 (Plon).

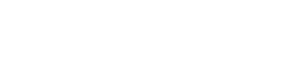




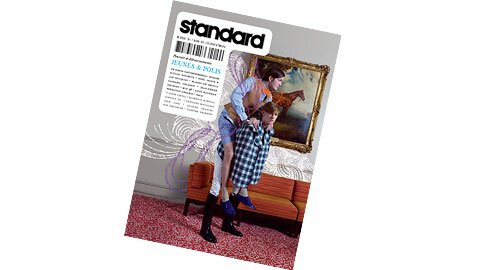
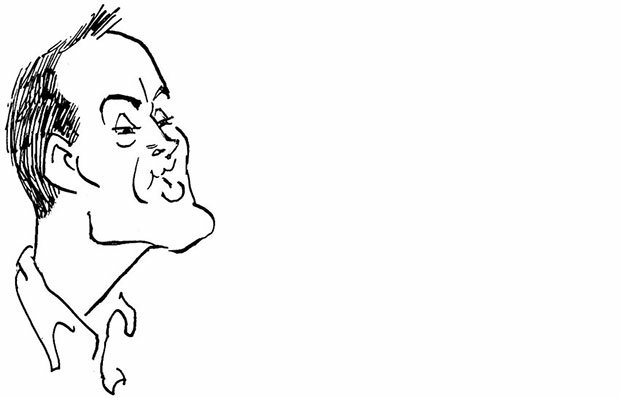

 TUMBLR
TUMBLR
