Théo Mercier : Du futur faisons table rase
Nouveau projet pour l’héritier des surréalistes, Théo Mercier. Accompagné du groupe éléctro trash Sexy Sushi, l’artiste présente ce week end au MAC de Créteil une comédie musicale aux allures de performance timbrée. Retour sur un interview de 2012 ( voir Standard n°34) quand l’adepte du beau bizarre formulait ses délires sur des sculptures totémiques.
Une première exposition il y a seulement deux ans, des articles dans Le Monde, Art Actuel, Beaux-Arts, le Los Angeles Times… Comment expliques-tu ce succès ?
Théo Mercier : Je rassure parce que je ne parle pas d’art. Je fais des propositions accessibles avec plein d’accès possibles, dont la satisfaction visuelle. Elle passe par la forme, la couleur, la matière, et surtout le déploiement d’un imaginaire, ce qui se fait de moins en moins. La scène française propose plutôt des questionnements, du recul…
Tu suis ce qui se passe ?
Par la force des choses, mais je suis plus attiré par la musique et le cinéma. Je me voyais grand bandit ou rock star. Je vais au concert au moins une fois par semaine, ça va du baroque au punk, du black metal au R&B, de Nine Inch Nails à David Bowie. Artiste, ça ne m’a jamais fait rêver. D’ailleurs, j’ai fait des études de design industriel spécialisé en ingénierie, un truc assez raide.
Le public te découvre en 2010 (nous bien avant, dans Standard no 23) avec Le Solitaire (énorme « Barbapapa » blanc sur une chaise). Même Martine Aubry, Fanny Ardant ou Sophie Marceau se sont fait prendre en photo devant…
C’est ce que j’appelle une œuvre touristique. J’aimerais les avoir, toutes ces photos. Cette pièce a fait parler [elle fait désormais partie de la collection de la Maison rouge], mais ce n’est pas la plus marquante. Elle crée une émotion avec le regard, avec sa masse en similispaghetti [des cordelettes enduites de silicone]. Le monumental qui parle de l’intime. Ce monstre peut évoquer le travail de l’artiste.
Quelle pièce préfères-tu ?
La Bête à deux dos. Elle décrit l’ambiguïté que j’aime : est-ce qu’on doit rire ? avoir peur ? est-ce que c’est gentil ? Des mains réalistes – fascinantes et dérangeantes parce qu’elles sont humaines et surdimensionnées – dépassent d’une boule de fourrure, on ne sait pas ce qui se cache dessous, si des personnes se protègent ou s’embrassent, ou si c’est un seul et même monstre. Je l’ai faite pour la Fiac cette année mais l’avais dessinée il y a quatre ans.

Tu es très productif. Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter d’autre ?
Rien. Après, c’est pas un boulot facile… Dans mes périodes d’atelier, c’est six jours par semaine, à heures fixes, de 9 heures à 20 heures, des horaires de bureau [rires]. Mais la grosse partie du travail est en dehors : la communication, l’organisation, le transport, les dessins, l’intendance…
Financièrement, tu ne mènes plus une vie d’artiste ?
Je l’ai menée à Berlin où j’ai été serveur pendant deux ans, en vivant dans des squats. Maintenant je peux payer mon loyer, mais pour combien de temps…
Ne te fais pas de soucis, tu es le seul à pouvoir rendre totémique un arbre à couilles
Toutes roses, toutes molles, on dirait du chewing-gum alors qu’elles sont censées parler de virilité. Il n’y en a plus dans ma dernière exposition [Le Musée des arts seconds, Galerie Gabrielle Maubrie en octobre dernier].
Non… mais il y a un nez-bite.
On est bien d’accord, ce n’est pas des blagues, on est dans le jeu. Même s’il méprise l’humour, l’art n’est pas fait pour pleurer ! Ça peut faire rire, mais on peut aussi être ému ou effrayé…
Il n’y a qu’à voir la home de ton site : squelettes, pierres tombales et l’inscription DEATH qui réserve une surprise sanglante.
Et j’avais le look gothique entre 16 et 19 ans. Le culte, l’effrayant, les vampires, les châteaux hantés, les sacrifices humains me fascinent.
Les dessins animés, les séries B ?
Je n’ai jamais eu de télé. Mes parents sont dans le cinéma, mon père dans la déco et ma mère costumière : pas de télé. Je me faisais chier, alors je faisais des trucs. Je vais beaucoup au cinéma. Dernièrement, que des déceptions : Contagion [de Steven Soderbergh], Hors Satan [de Bruno Dumont]… Le Tintin [de Steven Spielberg], une cata.
Tu travailles avec la plus grosse équipe d’effets spéciaux de France…
Oui, des gens qui m’aident depuis mes débuts : No Man’s Land, à Saint-Ouen. Ils font tous les films de Besson, Jeunet… Les pièces à échelle humaine, je les fais à l’atelier avec mon assistant, et les grandes, celles qui nécessitent des résines, des trucs chimiques un peu osés, ils s’en chargent.
Te positionnes-tu parmi les héritiers des surréalistes ?
Pour le travail sur le rêve, peut-être, c’est la dernière période à avoir travaillé sur l’imaginaire ; mais je ne le revendiquerais pas, je ne connais pas assez, et surtout : j’essaie de ne pas parler d’art.
Comment en es-tu arrivé là, alors ?
Depuis tout petit, les potions m’intéressent. Mes connaissances techniques, je pensais les appliquer à des bouteilles de shampooing. J’ai été stagiaire chez Matthew Barney, qui travaillait avec des plastiques et qui ouvrait des portes que j’étais loin de soupçonner ! C’est en le regardant que je me suis dit que c’était super comme boulot. Alors, plutôt que des objets design, je fais des sculptures en acrylique. Mes squelettes, je les recouvre, même quand ils sont vrais.
De vrais squelettes ?
Tu es de la police ? J’ai mes petites adresses. Ça n’a jamais posé de problème.
Dentiers, crânes, bananes, glands : une sémantique assez variée…
Je ne suis pas un artiste conceptuel, le sens vient après. J’essaie d’apporter un regard décomplexé sur ce qui peut paraître obscène ou tragique. Les familles mexicaines picolent et jouent de la musique sur les tombes : des rires, des jeux, des musiciens… la mort rieuse, j’y crois vraiment.
Pourquoi inclure des objets d’art africain dans tes nouvelles pièces ?
Parce que les arts premiers ont une fonction usuelle, sans discours.
Et qu’il y a quelque chose d’enfantin dans les masques ?
Non. Je ne fais rien d’enfantin, tout est très maîtrisé, le traitement des peintures (huit couches avec des dégradés) et des formes n’est pas naïf. Rien de spontané, aucun hasard, la moindre ouverture de bouche est calculée. Je suis un vrai maniaque, parfois j’aimerais avoir une gestuelle plus libre.
« Don’t make love if you have something better to do. » Cette phrase sur ton site, c’est ta devise ?
Non, ça vient d’un album de hip hop, je les change régulièrement en fumant des pétards.
Tu n’as pas de phrase qui t’aide à rester droit dans la merde ?
Puisque je détourne des choses graves, en général, je prends celle-ci, elle est pas mal, merci : rester droit dans ma merde.
Voir son portfolio dans Standard n°23 spécial cosmos.
A l’occasion de la sortie de All You Can Eat (éd. Dilecta) une monographie en signature demain soir à la librairie Yvon Lambert, (textes de Jean-Max Colard, Stéphane Corréard, Tania Rivera et de Jérôme Lambert), de son solo show, Snow Fakes Corn Flakes, au Lieu Unique à Nantes du 5 mars au 28 avril prochain, l’interview que le futur résident de la Villa Médicis à Rome (jusqu’en avril 2014) nous avait accordé en début d’année :










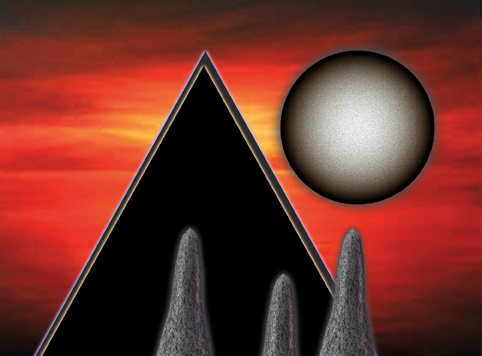




 TUMBLR
TUMBLR
