Laurent Joffrin : « Entre deux trapèzes sans filet »
Nouvelle très bonne archive en ligne : Laurent Joffrin (re)nommé en juin à la tête de la rédaction de son journal, était interviewé dans Standard n°23.
Alors qu’un nouveau Libé fleurissait en mai 2009, Laurent Joffrin, 56 ans alors, directeur de la publication et de la rédaction, signait Média-paranoïa, court « plaidoyer » en faveur d’un journalisme trop souvent associé aux « puissants ». Il écrivait : « Les informations sont presque toujours fiables, mais une majorité du public les met en doute. » Vous y croyez ?
C’est un détail, mais : Laurent Joffrin passera la première moitié de cet entretien les deux pieds sur le bureau.
Média-paranoïa naît-il d’un agacement à l’égard des « procureurs du journalisme », de la « défiance » devenue « phénomène trop massif » ?
Laurent Joffrin : De l’incompréhension, plutôt. Dans certains débats, le public nous considère tous comme les marionnettes d’un pouvoir occulte, économique ou politique. Et si la presse commet beaucoup d’erreurs, ça, ce n’est pas vrai. Faut regarder média par média au lieu de juger à l’emporte-pièce. Même dans les milieux intellos, c’est implanté, rarement argumenté ou démonté. L’accueil du livre est plutôt bon, avec cette nuance : je serais trop optimiste. C’est une défense, probablement trop indulgente à l’égard du système médiatique.
C’est une commande ?
Non, on m’a demandé un truc sur l’économie de la presse, ça me faisait chier, j’ai proposé ça, écrit l’été dernier, en deux mois. Comme un long éditorial. Il y a des dépendances, des pressions, évidement, mais pas de manipulation parce qu’on est en démocratie. Et aussi cette idée paralysante qu’il faudrait sortir de l’économie de marché pour avoir une presse libre ; on a essayé, ça a donné des journaux asservis à l’Etat. Ça peut s’améliorer avec des idées simples, évoquées lors des états généraux de la presse en janvier : des chartes de production de l’information et la reconnaissance d’une communauté rédactionnelle.
Un contrat qui permettrait de savoir comment sont faits les journaux ?
Oui. Des principes de bon sens connus depuis un siècle : respect des sources, ne rien publier sans deux, trois vérifications, et si on met en cause quelqu’un, on l’appelle, et pas une demi-heure avant le bouclage. Si cette charte est violée, le lecteur peut le signifier publiquement. Cela permettra de hiérarchiser les journaux en fonction de leur crédibilité.
Ces règles sont-elles majoritairement respectées, en France ?
Ça dépend. Dans Le Monde, Le Figaro, Libération, à peu près ; et encore, ici, il faut se battre pour éviter les billets militants, les préjugés – un truc positif pour Sarkozy, on en fait une brève, ce n’est pas très bon. Ce métier implique de confronter ses idées à la réalité. Certains universitaires pensent que nos articles sont des cours, vérifiés vingt-deux fois. Faux, on travaille en trois, quatre heures, sinon le quotidien paraîtrait tous les trois jours. A fortiori pour la radio, la télé, Internet. A l’inverse l’AFP, fiable et reconnue, produit les traits essentiels d’un événement pour que chacun puisse s’en faire une idée indépendante – comme des grossistes en nouvelles.
Ces « billets militants » sont pourtant liés à l’histoire de Libé.
On peut faire des campagnes pour une cause importante. Mais dans le cours ordinaire du temps, il faut être crédible, honnête avec au minimum de candeur, en sachant que ce sera toujours imparfait.
« La tradition française, c’est le commentaire, non l’enquête. » Arriverons-nous à le séparer de l’information pure, à l’anglo-saxonne ?
C’est le combat de la profession, actuellement. Montrer qu’on a des règles indépendantes de production de l’information. C’est difficile : ma génération est d’accord, parce qu’ils ont été militants dans leur jeunesse et qu’ils en sont revenus, en se disant qu’il fallait raconter le monde avant de le transformer. Les journalistes des années 90-00, très marqués par les combats liés au grand mouvement social de 1995, sont plus radicaux. A Libération, cette génération, c’est très « gauche », politiquement correct et un peu chiant, je trouve. Ça implique une pédagogie constante, « non, cet article est trop biaisé, etc. »
Les journaux d’aujourd’hui seraient moins bons, moins documentés.
Ce n’est pas vrai du tout, ils sont bien meilleurs. Il suffit de reprendre les vieux numéros. La presse s’est continument améliorée sur trente ans ; moins maintenant, faute de moyens. Mais Le Monde est plus fiable et objectif qu’il y a vingt ans. Le Nouvel Observateur, c’était catastrophique : sur la contre-culture rock, on a cherché ce qu’ils avaient écrit sur Woodstock en 1969, huit lignes ! Les mecs étaient passés à côté.
Cette évocation d’un supposé « âge d’or » est assez fréquente vis-à-vis de Libé.
Il y a toujours la nostalgie des origines : les gens disent que Libération était un journal très engagé et qu’il est devenu mou. Quand on va chercher les numéros des années 70, c’est épouvantable : d’abord c’est moche, en noir et blanc, très peu d’illustrations, ce n’est pas très bien titré, mal écrit – enfin pas toujours, on sent que ça va évoluer et que certains écrivaient très bien. Un canard maoïste, ce n’est pas une garantie de sérieux. Lutte ouvrière et la contre-culture étaient mises en exergue, il y avait de la vie. Mais sur le plan de la qualité journalistique, je le répète, c’est épouvantable. Prenons l’affaire Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais) : en avril 1972, on retrouve le corps d’une jeune fille d’ouvriers, nue et violée, derrière la maison d’un notaire accusé par le juge d’instruction. L’organisation maoïste fait campagne sur le « crime de la bourgeoise ». Très vite, les flics s’aperçoivent que le notaire est innocent, que la fille a été tuée par son copain, mineur, nommé Jean-Pierre. La thèse, tentante, de la lutte des classes était bidon – et pourtant Libération titre en énorme « Jean-Pierre est innocent » avec en tout petit « affirment ses avocats ». Ridicule ! On n’aurait pas même pas l’idée, aujourd’hui, de faire ça !
Pareil pour Le Monde ?
De la même manière, je vois mal comment Le Monde pourrait reproduire son erreur tragique d’avril 1975, quand Phnom Penh est prise par les Khmers rouges qui, en vingt-quatre heures, évacuent toute la ville y compris les malades dans les hôpitaux : violence extrême, exécutions sommaires, mise en place d’un système concentrationnaire et fou. Le Monde a présenté ça comme une « libération », analogue à celle de Paris, de la joie, des pleurs. Il a fallu un an ou deux pour que la vérité se fasse. Alors que leur journaliste était sur place, qu’il voyait ces gamins en noir, armés de mitraillettes… Ça n’arriverait plus : il y aurait toutes les télés, les radios, ou alors rien et cela créerait de la suspicion. Il y a maintenant tellement de journalistes qu’on finit toujours par connaître les faits, même si on se trompe sur les interprétations.
Le « niveau » augmente avec la technologie ?
On peut défendre l’idée, oui, que ça a progressé.
Pourtant vous écrivez : « Internet est présenté de manière fallacieuse comme le refuge de l’esprit critique et de la liberté de parole, alors que la plupart des informations importantes, des enquêtes approfondies, sortent toujours dans les médias classiques. » Vous n’apprenez rien sur la Toile ?
Si, j’apprends des trucs, ça dépend de quoi on parle : les sites des grands journaux, alimentés à 80 % par les agences, sont réalisés par les mêmes équipes. Le reste est fait uniquement à partir des dépêches – désormais accessibles à tous, nouveauté. Ce qui est écrit est juste – grosso modo – et rédigé selon les règles traditionnelles. Donc la presse sort les infos. Après, des francs-tireurs comme Bakchich révèlent de petits trucs. Le Net est plutôt source de documents bruts, de vidéos. C’est la mise à disposition qui est nouvelle, pas les modes de production. Et les blogueurs – comme nos chroniqueurs – sont de parti-pris, il faut constamment vérifier.
Vous dites que « Libération refuse les publi-reportages pour tel ou tel pays que Le Monde, lui, accepte. » Pourriez-vous préciser ?
Il y a des pays – le Maroc, ceux du Golfe – qui se font de la pub en achetant des pages, « Le Sultan explique que le développement de son pays est formidable. » C’est écrit au-dessus « publi-information » en petit. On fait aussi du publi-rédactionnel, mais pas sur les pays, encore moins concernant les régimes dictatoriaux. C’est un peu emmerdant, quand-même. Et si ça trouble le lecteur, s’il ne voit pas ça comme de la pub, c’est douteux, moralement.
Vous écrivez aussi : « Si rien ne change, l’avenir est tracé : les médias seront de moins en moins capables d’entretenir des rédactions nombreuses, expérimentés, talentueuses. » Inquiet ?
Un peu, oui. Notre modèle s’effrite, et il n’y en a pas d’autre. On ressemble à des trapézistes volants entre deux trapèzes – et sans filet.
Toute la presse ne peut pas s’écrouler d’ici trente ans, si ?
Non. Un quotidien, c’est un peu cher à l’année, mais c’est synthétique, professionnel. Dans le cas de la tuerie de mars dans un lycée allemand, la dépêche tombe sur le Net à 10h, on a la photo, le commentaire d’un blog et si on veut du recul, on trouve l’historique de vingt ans de massacres dans les écoles. Le lendemain, chez nous, tout le travail est fait, complété par des entretiens avec des experts, se lisant vite. Si on fait ça sur cinq ou six sujets tous les jours, on garde une utilité et un avantage commercial. L’autre supériorité des journaux, c’est le style, la qualité d’écriture, le récit raconté comme un roman, prenant. Un long reportage sur le Net, on ne le lit pas vraiment puisqu’on ne passe, en moyenne, qu’onze à douze minutes sur les sites d’infos. On a donc une chance. Mais peut-être que les gens préfèrent composer leur menu eux-mêmes.
Laurent Joffrin : « Ma fille, 24 ans, veut être journaliste en presse écrite. Je ne l’encourage pas, mais ne veux pas la décourager non plus. Je suis inquiet, ouais. »
Si vous aviez 25 ans, seriez-vous journaliste en presse écrite ?
[Il rit] Ma fille a 24 ans et veut être journaliste en presse écrite. Je ne l’encourage pas, mais je ne veux pas la décourager non plus. Je suis inquiet, ouais : les emplois dans la presse nationale, il n’y en a pas beaucoup. Même la télé et la radio n’ont pas des débouchés formidables.
Dans nos colonnes en 2008, Florence Aubenas remarquait que certains papiers de Libération (l’ouverture, les portraits) avaient diminué d’un tiers, voire de moitié. « L’avenir de la presse doit investir dans la longueur », dit-elle. Les textes longs sont-ils compatibles avec l’époque ?
Elle a tort et elle a raison : si on fait long, faut pas être chiant. Si vous avez le récit complet de la tuerie, on publie vingt feuillets* sans problème ; enfin, non, à Libé, on en ferait dix. Le format moyen est à deux et demi, trois. C’est comme un repas, s’il n’y a que des plats de résistance, on s’ennuie. On ne peut pas faire que du long, quoique La Croix a pris cette option.
Pourquoi ?
Le problème, c’est que le lecteur est double : il a un moi et un sur-moi, il veut des papiers de fond, et on s’aperçoit qu’il ne lit que les brèves people. Mais s’il n’y avait que ça, il serait mécontent. Il faut parler aux deux, à la vision idéale et à la pratique réelle. Les pages du milieu de Libé contiennent beaucoup de petits articles, ça nous a longtemps handicapés parce que ça ressemble vaguement aux gratuits. On a changé pour des ouvertures plus longues avec encadrés, mais l’image est restée. Notre début est assez fort, et après, l’œil n’est pas accroché, on tourne les pages et on pense qu’il n’y a rien, alors qu’il y a beaucoup.
Quels seront les enjeux de la nouvelle formule ?
On va jouer uniquement la plus-value, en considérant que les gens savent à peu près ce qui se passe. On leur vendra soit des choses qu’ils ne savent pas du tout, soit des choses qu’ils ne savent pas sur des sujets connus. Ça demande plus de travail, de clés, de la compréhension – avec la même équipe.
Vous mentionnez la fausse liste de détenteurs de compte à l’étranger dans l’affaire Clearstream. Avec le recul, quelle est votre opinion sur Denis Robert ? Il dit que vous le traitez « avec des pincettes ».
[Il soupire] C’est est un peu gonflé, on l’a défendu tout le temps, à Libé, à L’Obs, il n’est jamais content, lui. Il a balancé un listing trafiqué par d’autres, il n’y est pour rien. En revanche, il n’a pas démontré que Clearstream était la grande boîte noire du blanchiment de l’argent mondial. Il y a peut-être eu des opérations frauduleuses avec fonds délictueux, mais il n’a pas apporté de preuve décisive. Il est un peu dans la psychologie du complot, à travers un journalisme subjectif, moins crédible. Il faut des infos – et il en a, avec sa taupe – mais il en a fait trop. Et ses adversaires, qui se sont battus comme des chiens, ont quand même gagné une grande partie de leurs procès.
Savez-vous quel mot revient le plus souvent dans le livre ?
Non.
« Puissant(s), puissance(s) », vingt-neuf occurrences.
Comment vous savez ça, vous ?
Je l’ai remarqué par hasard. Il apparaît parfois trois fois par page.
« Puissant » ?
Pensez-vous que Libération soit un journal puissant ?
Oui, quand même : pas sur le plan économique – c’est le moins qu’on puisse dire – mais par son influence. Les puissants regardent le journal. Suite aux violences étudiantes en Grèce de décembre 2008, Fabius évoque un « risque de contagion » et parallèlement, il y a des affrontements étudiants à Brest, plus quelques échauffourées en Allemagne. Pas de quoi parler d’Europe embrasée, mais, bon, on publie un sujet. Quinze jours après, je dîne avec [Xavier] Darcos chez des gens – je ne le connais pas bien, hein – et il me raconte que la Une de Libé a déterminé Sarkozy à retirer le lendemain son projet de réforme des lycées, parmi d’autres indicateurs. Là, il y a une influence, involontaire. Et c’est un peu satisfaisant – mais ça le sera quand on aura augmenté nettement nos ventes [il sourit].
Où en sont-elles ?
On diffuse à 120 000 exemplaires, dont la moitié en kiosques, auxquels s’ajoutent les abonnés, les agences, notre présence dans les avions. Mais l’audience est plus importante : selon les sondages, chaque numéro serait lu par huit personnes. Ça me paraît beaucoup.
Quels médias consultez-vous ?
Quand je me lève, Europe 1 pour la Revue de presque géniale de Nicolas Canteloup, et Claude Askolovitch. Puis France Info par patriotisme, puisque j’y parle [trois fois par semaine à 8h40]. Je regarde ensuite les sites de Libé et celui de L’Obs, dont je suis l’un des créateurs. Puis je lis Libé et Le Figaro que je reçois chez moi. Quand j’arrive ici, je feuillette tous les autres et je regarde LCI. Il y a parfois de bons sujets dans Marianne, beaucoup dans Les Echos.
Laurent Joffrin : « Le lecteur est double, moi et sur-moi : il veut des papiers de fond et ne lit que les brèves people. »
Comment avez-vous appris ce métier ?
J’ai voulu être journaliste à 7, 8 ans, en lisant Tintin. C’est trompeur : Tintin n’écrit jamais d’articles. J’ai fait Sciences Po avec l’intention de poursuivre via l’ENA puis, un jour, sur un bateau – je fais de la voile –, je me suis dit que si je devenais fonctionnaire, j’allais me faire chier. J’ai appris le métier au CFJ [diplômé en 1977]. Et puis j’étais militant [aux Jeunesses socialistes] : on apprend beaucoup en répondant à ses adversaires sur des notions apprises à toute vitesse et aussi précises que le budget de l’Etat. Après mon passage à l’AFP [1978-1980], je me suis aperçu je pouvais écrire des éditos assez vite, pas trop mal. Mon premier article réel, c’est un scoop pour Le Matin : Giscard avait lancé un emprunt à succès indexé sur l’or, dont le remboursement lui avait coûté 80 milliards de francs. Des potes dans la finance m’ont raconté cette histoire, je l’ai amené au Matin qui l’a mise en Une, pas mal. Mais j’ai vraiment appris lors de mon arrivée à Libération en 1981. Le journal était tout petit et progressait beaucoup. Il y avait une grande liberté, on allait au bout du monde.
Meilleur souvenir de reportage ?
La Pologne, au moment de l’état de siège [proclamé le 13 décembre 1981] quand tous les syndicalistes furent jetés en prison. J’ai couvert ça un mois, à Varsovie, seul pendant quinze jours. J’allais voir les militaires, c’était une révolution, on voyait l’Histoire se faire, bien. Mes dix jours à Sarajevo encerclée par les snipers serbes, moins. C’était un peu effrayant, on se faisait tirer dessus tout le temps.
Le pire ?
Je n’ai que de bons souvenirs en reportage. Mes plus mauvais, c’est d’avoir attaqué les gens injustement. Dans les pages économiques de Libé, au sujet de Pierre Bérégovoy alors ministre des Finances, j’avais écrit « le brave Bérégovoy » parce qu’il avait l’air un peu bonhomme et que tout le monde disait qu’il n’avait « qu’un » diplôme d’électricien. Il me téléphone le lendemain : « Mais pourquoi le « brave » ? Parce que je n’ai pas fait l’ENA, c’est ça ? » J’étais un peu gêné [grimace embarrassée]. En tant que rédacteur en chef, c’est quand on se plante ; au début de l’affaire Baudis, on l’a accusé, un désastre ; on a corrigé le tir, mais on a mis le temps. Une autre fois, [l’ancien ministre de l’Industrie] Gérard Longuet me fait venir dans son bureau très tôt et me dit, tout blanc : « On m’accuse de malversations mais les apparences sont trompeuses. » Je rentre dans une salle avec une table immense jonchée de documents. « Regardez ce que vous voulez, vous verrez que je suis innocent. » Il tremblait. Je suis parti, je ne suis pas flic.
Vous regrettez ?
On voyait la cruauté du métier : il ne s’en est jamais remis. C’est le plus dur, quand on assassine les gens. On a aussi poursuivi Strauss-Kahn avec un acharnement incroyable sur l’affaire de la MNEF [en 1999], mais il le méritait. Il a obtenu un non-lieu, la Justice nous a désavoués. J’aime pas ça. Je me mets à leur place, ils sont tout à coup salis et ne peuvent rien faire. On n’influence pas tellement l’opinion des gens mais sur les individus, on a un pouvoir destructeur. Quand on balance [en décembre dernier] les dépenses et la vie privée de Julien Dray, le mec est mort – enfin, mal. C’est ravageur.
Enfin, quelles sont vos règles ?
Elles sont dans le bouquin. En tant que directeur, j’en ai d’autres : il faut faire du journalisme, et que ça se vende. C’est chiant, le journaliste ne devrait pas s’en préoccuper, dans un monde idéal.
Une secrétaire de rédaction l’intercepte. La chronique hebdomadaire de Daniel Schneidermann le mentionne comme candidat potentiel à la direction de Radio France. Dans l’ascenseur, pestant contre cette rumeur « ridicule », Laurent Joffrin évoquera la possibilité d’un « leurre » : « le successeur serait déjà nommé, on laisse filtrer des noms pour semer le trouble et créer la surprise. » Paranoïa ? On verra.
* Un feuillet compte 1 500 caractères, espaces compris.
Média-paranoïa (Seuil, 14.20 euros)

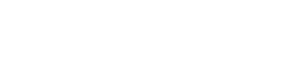








![Arlette Chabot ©Tom[ts74]](/wp-content/uploads/2010/12/Arlette_Chabot.jpg)


 TUMBLR
TUMBLR
