Golshifteh Farahani : “En Iran, l’esprit est libre”
Golshifteh Farahani : « En Iran, notre esprit est libre »
Dans l’adaptation du Goncourt d’Atiq Rahimi, Syngué sabour – Pierre de patience, l’actrice iranienne libère le corps et la parole d’une femme « du monde ».
La pierre de patience est un caillou précieux auquel on souffle ses secrets jusqu’à ce qu’il éclate. Chez Golshifteh Farahani, ce qui éclate d’abord, c’est sa beauté. Puis sa vivacité, canalisée par un flot de paroles intelligentes. Star exilée pour trop-plein de liberté et pour avoir accepté en 2008 de tourner Mensonges d’Etat, le thriller de Ridley Scott avec Leonardo DiCaprio, elle est la première Iranienne à avoir franchi les portes de Hollywood en trente ans. La grâce qu’elle offre à Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (2011), ou A propos d’Elly d’Asghar Farhadi (2009), Golshifteh semble la réapprendre pour Syngué sabour. Ce récit d’une réappropriation des sens, né de la plume du Franco-afghan Atiq Rahimi, a obtenu le prix Goncourt en 2008 – l’auteur en signe lui-même l’adaptation cinématographique. Sous la grande verrière de la Ménagerie de Verre, entre les changements de look, Golshifteh exécute des petits bonds avec une énergie enfantine que l’on regrette d’estomper sous de longues tenues sages, en images immobiles.
Ton vrai prénom est Rahavard, plus simple à retenir que Golshifteh. Pourquoi ce pseudo ?
Golshifteh Farahani : Ce n’est pas un pseudo, mon père l’a inventé d’après le livre John et Shifteh de Romain Rolland [histoire du livre]. Pour le gouvernement iranien, c’était un prénom inacceptable, de gauche, et avant la révolution islamique [1979], ça ne passait pas. Donc, sur mes papiers, c’est Rahavard, mais on m’a toujours appelée Golshifteh. John est intraduisible, un mélange de « cœur » et « corps », et Shifteh, « fleur » : « celle qui aime les fleurs ». A Los Angeles, on m’a demandé de raccourcir, mais j’ai dit non, c’est mon nom, j’y tiens, je suis la seule à le porter dans le monde.
Comment se fait-il que tu sois trilingue ?
Mes parents sont francophones. L’anglais, je l’ai appris avant l’âge de l’école, on prenait des cours très petit. Et quand, à 12 ans, je suis allée rendre visite à mon grand-père et ma tante, exilés aux Etats-Unis depuis la révolution – je ne les avais jamais vus –, j’ai continué d’apprendre, de manière instinctive.
Le film est en dari, une des langues afghanes, avec le pachto et l’arabe…
Oui, le dari est un peu différent du persan ; les Perses le comprennent, mais ont besoin des sous-titres, un peu comme vous et le québécois. Le matin, j’écoutais les dialogues enregistrés par une femme, pour apprendre l’intonation. C’était très important que je parle parfaitement pour Atiq.

© Gianluca Tamorri, Robe Giorgio Sautoir et bracelet portés à la main droite Anjli London Bracelet porté au bras gauche Bernard Delettrez
Golshifteh Farahani : « La France est le pays de l’impossible ! La tradition est un système de castes. »
C’est rôle le plus dialogué, presque un monologue. La parole est-elle libératrice ?
C’est dans notre culture de cacher, de ne pas parler beaucoup. Ne pas dire ce qu’on pense, c’est politique : l’Iran est attaqué depuis mille ans par les Mongols, les Turcs, les Arabes… alors, le silence est une protection dans une zone géographique où tu peux mourir à cause d’une phrase. Et ce jusque dans les familles. Même mon père, qui est un intellectuel très libre, reste traditionnel sur ce point. Et puis les rapports père-fille ne sont pas les mêmes qu’ici, il y a une distance, on ne se prend pas dans les bras, on ne parle pas de nos copains ou de nos expériences. La valeur de la parole en Orient est celle du prix qu’on peut payer pour avoir parlé, c’est-à-dire très cher. L’exécution. En France, quoi qu’on dise, on ne risque même pas la prison. J’ai pris conscience de ça doucement, sans m’en rendre compte, sans phrases précises : je suis devenue libre, je suis devenue ce que je suis vraiment.
A qui se confier, en Iran ?
La confession religieuse n’existe pas, mais il y a des psychanalystes avec qui on peut se libérer. Et, bien sûr, notre pierre de patience, cette personne qui jamais ne trahira ton secret. J’en ai deux. Un garçon en Iran et une fille en France. Mais, parfois, on s’interdit tellement d’y penser qu’on oublie ses propres secrets.
En quoi ton identité iranienne résonne-t-elle dans le rôle d’une femme afghane (pour autant que ce soit bien le pays où se passe le film vu qu’il n’est pas précisé) ?
Dans le livre, il est écrit « nulle part », mais bien sûr c’est l’Afghanistan, ça se voit dans les vêtements, la langue. On a tourné une petite partie à Kaboul, et le reste à Casablanca. Cette femme peut être chinoise ou toutes les femmes du monde, c’est pour ça que le livre a été un best-seller. Elle échappe aux clichés sur les Afghanes : faibles, passives. Tout ce qu’on pense qu’elle est, elle ne l’est pas. Elle est juste un personnage. D’ailleurs, elle n’a pas de nom. Donc je n’ai pas fait de parallèle avec mon pays.
Qu’est-ce que cela fait de jouer une femme prisonnière des codes d’une société et de son foyer, quand on est exilé de la sienne ?
C’est vrai que je joue souvent des femmes fortes qui veulent se libérer. Mais je pense qu’Atiq recherchait avant tout quelqu’un qui puisse parler dari, qui ait l’âge et le physique. Dans la vie, j’ai essayé d’être forte parce que ce n’était pas possible autrement. Si je suis exilée, mes rêves sont toujours en Iran. Une grande partie de mon âme vit là-bas. Je n’ai jamais voulu vivre ailleurs, j’espère un retour. On a une liberté qu’on ne trouve nulle part. C’est surprenant de dire ça, car nous n’avons pas les Droits de l’Homme, mais notre esprit est libre… Tandis qu’il est tellement occupé en Occident, prisonnier de la société qui rend esclave du temps.
Depuis quatre ans, tu vis à Paris. Qu’est-ce qui te manque le plus ?
L’odeur des saisons. Même en ville, on sent les quatre. Ici, il n’y en a plus que deux. Et dans les pays développés, on est coincé entre l’angoisse et le regret : les gens vivent pour le futur : construire, construire, toujours… ou dans le passé. Ici, le présent est un temps perdu. Chez nous, demain n’existe pas, la guerre nous l’a appris. Alors, on profite de chaque moment. En Iran, on travaille beaucoup, mais on apprécie autrement ce qu’on a. Chaque moment est précis… euh précieux. Pour Bouddha, le Nirvana, c’est vivre le présent. Il suffirait d’un peu de réforme en Iran et on y serait…
L’idée d’insoumission sous-jacente dans Syngué sabour passe en partie par celle de la vengeance. Quel est ton rapport au pardon ?
Il n’y a pas de vengeance. Si elle avait voulu, elle aurait pu quitter son mari dans le coma dès le début, mais elle reste. Elle est dans le pardon, et le corps de cet homme devient sa pierre de patience. Elle est en colère, ça oui, et il est si vulnérable qu’elle aurait pu se venger facilement, mais elle ne fait rien. Elle se libère et utilise son mari pour l’assumer. Moi, je pardonne, mais je n’oublie pas. Je n’ai plus de colère ni de tristesse, je suis en paix avec moi-même et le monde, mais je ne pourrais jamais dire « je te pardonne » ; je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis qui pour pardonner quelqu’un ?
Golshifteh Farahani : « Dans la vie, j’ai essayé d’être forte parce que ce n’était pas possible autrement. »
Une des scènes raconte l’histoire de Mahomet et Khadija en concluant que c’est elle qui aurait dû être un prophète. Et si Dieu était une femme ?
Dans notre langue, on n’a pas de genre. Tout est à la troisième personne. Est-ce Dieu, un homme ou une femme qui parle dans les Ecrits ? Ce « il » a permis à de nombreux poètes d’être sauvés en jouant sur la confusion.
Tu aurais pu être pianiste. A 14 ans, tu n’es pas allée passer l’audition du conservatoire de Vienne. Tu savais déjà que le cinéma serait ta vie ?
J’ai pensé qu’il serait une meilleure langue pour avoir de l’influence sur le peuple, sur la masse. Je n’ai pas de piano ici, mais je joue dès que possible, la musique est restée avec moi, je suis contente de l’avoir pour base. Vienne était le meilleur endroit pour étudier le classique, mais je ne regrette absolument rien. Il y a toujours une raison.
Vingt-sept films depuis ton adolescence, c’est de la boulimie ?
Ce n’est pas énorme, ça représente un ou deux par an, j’aurais pu en accepter le double. J’ai choisi ceux que j’avais vraiment envie de faire uniquement. A l’époque de Mohammad Rhatami [président de la République islamique de 1997 à 2005], l’Iran était le troisième pays producteur de films. Aujourd’hui, il y a encore quatre-vingts à cent sorties par an. Les Français pensent que le cinéma iranien a commencé avec Abbas Kiarostami ! Je vous conseille Forough Farrokhzad et The House is Black, un film en noir et blanc avec Sohrab Shahid Sales [1962].
Tu dis : « Quand on est artiste en Iran, on n’est rien. » Et aussi : « En Iran, j’aurais pu être une actrice riche. Je suis un petit oiseau dans un grand océan maintenant. » Des propos contradictoires ?
Non, car on n’est rien aux yeux du gouvernement, mais le peuple a beaucoup de respect pour nous – on n’imagine pas des stars invitées au journal de 20 heures, par exemple, car artiste, ça n’existe pas comme métier. Le problème de ce pays est que le gouvernement pense une chose et le peuple une autre. Au moment de la confiscation de mon passeport, les gens étaient en train de prendre des photos avec moi à l’aéroport.
Mensonges d’Etat avec Leonardo DiCaprio a fait s’envoler ta cote internationale et a marqué le début des problèmes avec les autorités iraniennes. Quel était le problème ?
Simplement la coopération avec les Américains. On ne peut pas tourner sans la permission de la cour islamique ; je l’ai fait et ça m’a coûté une interdiction de sortie de territoire. Je suis partie grâce à une caution [deux millions d’euros], que j’ai récupérée par la suite. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire Elle joue, le roman de Nahal Tajarod, tout est expliqué dedans [Albin Michel, 2012]. Cette Iranienne est l’épouse de Jean-Claude Carrière, scénariste de Syngué sabour à qui Atik a demandé de trahir son roman.
Quelles sont les conditions d’acceptation des scénarios ?
Même Dieu ne les connaît pas ! C’est tellement compliqué, ça dépend de tout et n’importe quoi, du caractère ou de l’humeur de la personne chargée de lire le scénario. Cinq instances délivrent leur accord pour trois autorisations différentes, car pour les festivals ou le public, ce n’est pas la même ! Et si un réalisateur montre un film à l’étranger sans être passé par le festival de Téhéran, il est censuré d’office. Le gouvernement stoppe même des films pour lesquels il a donné des subventions.
Golshifteh Farahani : « En Occident, le présent est un temps perdu. »
Aurait-on pu réaliser ces photos en Iran ?
Pas du tout, c’est sans voile ! Il ne faut pas qu’on voit les cheveux des femmes. Nous n’avons pas de magazines ou de photos de mode. On présente les nouveautés sur des images représentant la vie quotidienne. On doit accepter la loi du pays où qu’on aille. Les actrices iraniennes comme Leila Hatami [prix de la meilleure interprétation pour Nader et Simin, une séparation, au festival de Berlin 2011] se couvrent la tête dans les cérémonies internationales mais pas dans la vie. La photo de moi dévêtue pour les Césars 2012 a généré 40 millions de vues en 48 heures.
Tu n’as rien tourné à Hollywood depuis Mensonges d’Etat. Sont-ils politiquement méfiants ?
Non. J’ai eu des propositions, qui n’ont pas abouti pour diverses raisons. Mais surtout, il faudrait y vivre, et pour l’instant, je suis en France. La Californie est tellement éloignée de tout ! L’impérialisme capitaliste y est insupportable… J’envisage éventuellement New York, la seule ville américaine habitable. Pour y monter peut-être une version du Mahâbhârata et Antigone avec Gregory Marcher. Mais je ne pense pas au futur, je laisse la vie m’indiquer le chemin. Il est aussi question d’adapter ma vie, d’en faire quelque chose de drôle, peut-être un one woman show. Je viens de la famille du théâtre et elle me manque beaucoup, je me sens comme une pianiste qui ne fait pas de gammes.
Marlene Dietrich reste ton modèle absolu ?
Pas vraiment un modèle, mais je l’admire pour ses rôles tellement différents dans L’Impératrice rouge ou Agent X27 [Josef von Sternberg, 1934 et 1931] : la dernière scène alors qu’elle doit être exécutée, elle met du rouge à lèvres juste pour être belle, et les gens la tuent. Elle est géniale. J’aime que sa beauté ne soit pas féminine. A l’inverse de Marilyn Monroe, Marlène est au-delà de la féminité, elle était un homme aussi, elle était juste un acteur.
Tu dis qu’un Obama chez nous est impossible, « c’est la réalité de la France . Pourquoi ?
Je l’observe profondément depuis que je vis ici. Et si les Etats-Unis sont le pays des possibles, la France est le pays de l’impossible [rires] ! Tu restes où tu es. La tradition est un système de castes. Je pense que notre génération ne connaîtra pas le changement, vous allez voir, ça va bouger plus vite en Iran !
Entretien Magali Aubert & Alex Masson Photographie Gianluca Tamorri Stylisme Perrine Muller dans Standard n° 38.
Le film
Flamme persane
Golshifteh Farahani est une héroïne. Dans la vie comme au cinéma. Il y a encore peu, Marjane Satrapi, connue pour son caractère bien trempé, nous disait être estomaquée par cette Iranienne, star pour le peuple, reniée par le gouvernement islamiste, capable de sortir des bonnes vannes sur Mahomet ou de protester contre le régime d’Ahmadinejad en posant sein dévoilé sur des photos de Mondino. Dans Syngué sabour – Pierre de patience, elle joue une épouse de moudjahidin dans le coma qui déballe ce qu’elle a sur le cœur. A travers elle, une parole et un corps sont rendus à toutes les femmes opprimées par des diktats dépassés. Investie, consumée par cette mission, il y a quelque chose d’autre qui brûle ici : la flamme qui fait les grandes tragédiennes, cette capacité à incarner la souffrance avec majesté. Sa performance de Shéhérazade afghane reprenant son destin en main, voulant changer le cours de l’histoire, mériterait de la voir couronnée. A. M.
Syngué sabour – Pierre de patience
D’Atiq Rahimi
En salles aujourd’hui

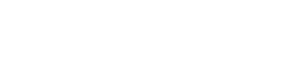






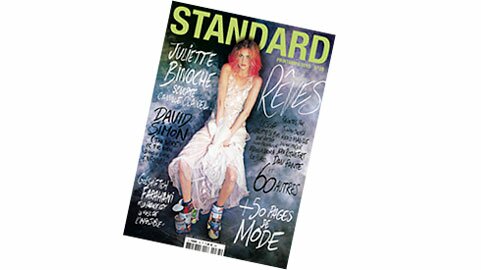



 TUMBLR
TUMBLR
