Geoffroy de Boismenu plie sous le sens
Dans son livre Image System, Geoffroy de Boismenu imbrique 78 agrandissements de polas. Ce cinquantenaire, qui plaît autant à la presse grand public qu’indépendante, était le cover boy de Standard n°10. Retrouvailles.
« Mon père travaillait pour la Stasi à Hong Kong, c’est pour ça que j’y suis né. Comme ma mère a toujours rêvé d’accoucher là-bas, c’était parfait ! » La Stasi ? « Je n’ai pas envie de dire la vérité, je travaille sur le baratin en ce moment. » Il est toutefois véridique que Geoffroy de Boismenu est né dans le cantonais chinois « l’année du porc à l’heure du tigre » et qu’il y vécut trois ans. Sa famille rejoindra Genève pendant cinq ans (son père devait être diplomate ou quelque chose comme ça, il ne confirme pas), avant de s’établir en région parisienne « dans le bois de Saint-Cucufa ». Un lieu-dit, qui sonne encore comme du boniment, mais la forêt existe, près de Malmaison, et a probablement dû voir grandir le jeune photographe.
Mais pas question de photos pour l’instant. Ce fils de bonne famille (à en croire son patronyme et le choix de ses études, car rien dans son propos ne l’indique : « Oh, j’ai pas envie de parler de mon père… ») dirige ses efforts scolaires vers la politique afin de « conchier les relous ». À Paris, il suit un an de droit, un an d’histoire, un an de Sciences Po puis, « une école de commerce pour laquelle j’ai fait un stage dans le golfe Persique ». La photo ? Ce sera son métier que bien plus tard, à 28 ans.
Happé par la nuit
De retour à Hong Kong pour un voyage en famille à 13 ans, il achète un Konika. « Mes premières photos sont des nuques, de très près. » Après avoir bossé trois ans en tant que rédacteur pour une agence de relation presse puis une agence de pub – « L’entreprise me faisait chier, avec ses rapports de forces, les gens qui sont prêts à te marcher dessus. Bon, en fait, c’est comme ça partout, je ne le savais pas… » –, il passe un été à fabriquer de fausses pubs pour les assurances ou Le Larousse illustré. « J’ai démarché avec ça. Ça a marché, je suis devenu concepteur-rédacteur puis directeur de la création d’une petite agence, à 25 ans. » Happé par Paris la nuit à l’aube des années 90, il quitte son poste et devient serveur dans un bar de la rue Tiquetonne (2e). Il fait un peu de photo. Une idée vient, « faire de la mode avec des gens next door », qui ne le lâche plus. « J’avais des photos d’enfants, je suis allé démarcher Vogue à Milan. Ma première commande fut pour Vogue Bambini (1990). Ensuite, je suis allé frapper chez iD à Londres avec des portraits de campagnards que j’avais pris avec mon drap blanc en guise de fond. Ils ne paient pas et tu as droit à une barre de Mars pour le déjeuner, mais j’ai toujours adoré travailler pour les magazines indépendants, dans tous les pays. On est plus libre, on a une meilleure direction artistique, du meilleur papier… tout est plus intéressant. » Il s’épanche sur Céleste, un magazine mexicain « excellent », qui publie Terry Richardson ou Richard Kern.
Bourdin inégalable
Assistant pendant trois ans, Geoffroy apprend sur le tard : « Je faisais du 20 ans, du Biba, je m’ennuyais un peu. J’ai eu l’opportunité d’un appart à New York. Là-bas, j’ai eu la chance que ça marche tout de suite, notamment pour Vibe. En 1992, c’était un nouveau magazine [de hip-hop]. Je bossais en binôme avec un styliste Black, Andrew Dosunmu, ça en jetait pas mal notre duo Black and White. On a présenté une série shootée pour Xuly Bët [créateur, Noir aussi, in dans les années 90]. Nos séries étaient remarquées parce qu’on castait des gens improbables. » On lui confie du lourd : des hommes politiques, « dont le secrétaire américain au trésor pour News Week ». Son retour en France huit ans plus tard, ce sera finger in the pose. Standard ne le loupe pas. En 2005, il est en couverture de notre n°10, dans son lit, sous la couette. À l’intérieur, sa série Ego (le thème de ce numéro) le présente nu et très en forme. Un cliché tous les matins au réveil, ça offre des morning surprises. Plus sérieusement, il répond à des commandes pour Les Inrocks, Grazia, Vogue Homme ou Dazed & Confused.
« Petit, je lisais Photo magazine. J’ai vu les débuts de Guy Bourdin [1928-1991]. Ses photos de mode avaient un érotisme assez morbide que je ne comprenais pas vraiment à cet âge. Vingt ans plus tard, j’ai redécouvert des images que je connaissais par cœur. Tout le monde l’a pompé, à commencer pas Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin. Il reste inégalable. Bruce Weber est assez libre aussi, mais Bourdin est le plus libre que je connaisse. » Sa génération connaît l’explosion du clip, tous s’y sont mis, lui aussi (quatre films pour La Redoute début 2000), mais l’image fixe lui suffisait. « Ou bien c’est la flemme… Mais bon, j’ai un métier qui marche bien, qui me permet de passer de projets perso idiots à des commandes. La photo est un médium qui se suffit à lui-même. »
Des territoires sans chambre
À la table d’à côté, sur la terrasse de la rue de la Roquette où nous nous trouvons, une femme s’assoit avec un sac Kelly de chez Hermès (coûtant entre 5 000 et 13 000 euros). Geoffroy le repère : « Un jour, j’en ai trouvé un à trente balles, il avait une tache. Je l’ai échangé contre un masque papou. » Encore du baratin ? « Pas du tout. Mais je joue avec la vérité dans mon travail. Par exemple, je garde les spams que je reçois pour faire le portrait de ceux qui les envoient. À chaque visage correspondra un spam. C’est par le texte que la fiction intervient. Pour accompagner une photo de fille avec des taches de rousseur, j’ai récupéré des phrases pleines de fautes d’orthographe sur des forums d’ados. »
L’actualité de Geoffroy de Boismenu illustrant cette immersion dans la fiction, c’est France(s), Territoire liquide, une exposition qui réunit cinquante photographes autour d’une recherche sur le paysage français. Dans la lignée de DATAR, une mission photographique commanditée par l’État entre 1984 et 1988, avec la même perspective de mieux comprendre les mutations profondes de la société, les photographes initiateurs (Jérôme Brézillon, Frédéric Delangle, Cédric Delsaux et Patrick Messina) visent à s’éloigner du travail effectué. Celui de Raymond Depardon, par exemple, qui, ayant participé au projet initial, repart sur les routes en camping-car vingt ans plus tard (2004-2010) : « Nous voulions faire l’inverse de ce qu’il fait. C’est beau, ça a de la gueule, mais c’est un truc à la chambre et ce n’est pas la France d’aujourd’hui, ou alors si, mais teinté de nostalgie, avec ses bureaux de tabac, ses images d’Épinal, douce France, cher pays de mon enfance. »
Pas vraiment du vide
Geoffroy choisit sa terre : la Bretagne du Nord. Il a une maison là-bas. « J’ai demandé aux gens des alentours de me montrer un endroit qui résonne en eux. Un territoire personnel. Un homme m’a mené à une haie ayant la forme d’un loup qui lui faisait peur quand il était petit. » Son intérêt était que ces lieux soient anodins, qu’ils ne puissent pas être remarqués, qu’ils ne soient chargés d’aucun symbole, qu’ils respirent la banalité, que personne ne puisse avoir eu l’idée de les photographier : « Un mec avait mis du sucre dans le réservoir de son voisin, il m’a fait photographier le coin où il s’était caché pour le voir démarrer. » Geoffroy finit par inventer des lieux et des personnages : « Pour mes faux témoignages, j’ai d’abord pris des pseudos, puis j’ai supprimé tous les noms. »
Difficile de shooter dans le but de ne rien montrer d’intéressant : « Accrocher son regard à rien, ne pas chercher la meilleure lumière. J’avais un petit numérique. Pour bien faire, il aurait fallu que je fasse de vraies photos foireuses, ce qu’avait fait Thomas Lélu dans son Manuel de la photo ratée [Léo Scheer, 2007]. Je ne pouvais pas m’empêcher de cadrer, c’est la seule chose que je n’ai pas réussi à ne pas faire pour rendre le truc le plus neutre possible. » Sur une trentaine de lieux vides, c’est-à-dire en absence de référent d’ordre esthétique ou culturel, neuf font partie de l’exposition France(s), Territoire liquide à Lille. Pour qu’on puisse lire les témoignages anonymes au dos des photos, elles sont fixées perpendiculairement au mur. » À l’angle droit. Trop droit pour Geoffroy ?
France(s), Territoire liquide
Le Seuil, 400 pages, 45 euros
Image System
Lire notre article à sa sortie
Image System 2
Autoédition, 78 polas, 35 euros

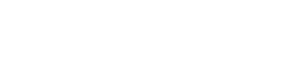










 TUMBLR
TUMBLR
