Gabriel Robinson : « La vérité ni plus ni moins »
Avant ce premier roman, Gabriel Robinson a tenu des années les rênes de ce magazine. Notre traditionnel questionnaire de Bergson est l’occasion d’arroser un arroseur, comme le héros des Heures pâles, fils de flic qui enquête sur son père.
Comment vous représentez-vous l’avenir de la littérature ?
Gabriel Robinson : Idéalement, du côté de la vérité, non pas factuelle, mais émotionnelle. À un moment, je ne sais pas quand mais je le souhaite, les gens, épuisés par le cynisme du monde des affaires, sa domination sur la vie politique et l’omniprésence de la publicité sur nos existences fragiles, vont se mettre à casser leur télé, à piétiner leurs smartphones. À réclamer, en masse, du vrai. Ce qui se traduira, littérairement, par une vague internationale des romans à succès, dans tous les styles, qui auront en commun un engagement total de leur auteur, au sens physique du terme.
Cet avenir possède-t-il une quelconque réalité, ou représente-t-il une pure hypothèse ?
Ce phénomène, que le New York Times titrera avec bonheur The end of bullshit, mettra du temps à s’installer. Il s’agira, pour les écrivains, de renoncer aux tartufferies, aux mots mous, aux lignes tièdes. Les plus téméraires en profiteront pour « s’ouvrir le ventre », les plus mesurés suivront ce conseil de Houellebecq dans Rester vivant : « La vérité est scandaleuse. Mais, sans elle, il n’y a rien qui vaille. Une vision honnête et naïve du monde est déjà un chef-d’œuvre. En regard de cette expérience, l’originalité pèse peu. Ne vous en préoccupez pas. De cette manière, une originalité se dégagera forcément de la somme de vos défauts. Pour ce qui vous concerne, dites simplement la vérité ; dites tout simplement la vérité, ni plus ni moins. »
Vous-même, où vous situez-vous dans cette littérature possible ?
Mon premier roman naît de la découverte de la double vie de mon père, que j’ai tenté de restituer avec la précision du reporter, en utilisant les outils de la fiction : dérives, oublis, rêves, pas de côté.
Si vous pressentez l’œuvre à venir, pourquoi ne la faites pas vous-même ?
J’y travaille, je la cherche. Je planche actuellement sur un roman d’aventures maritimes, un truc à la Jules Verne où rien ne sera autobiographique, sauf les sensations. J’aimerais faire dévier mes souvenirs vers le pôle Sud.
Avez-vous conscience de vous inscrire, avec Les Heures pâles, dans cette tradition littéraire mettant en scène un personnage principal dont la profession est journaliste, de Rouletabille à Bel Ami ?
Mon cher, comme l’a écrit Balzac, un journaliste est un acrobate… Vous tombez bien : exerçant moi-même cette noble profession, il ne se passe pas une semaine sans que je ne pense à Illusions perdues, à ce malheureux Lucien « se jetant dans les journaux » à défaut de vivre de sa poésie, ayant soudain « droit de vie ou de mort sur les œuvres de la pensée » et découvrant à ses dépens que « le journalisme est un enfer, un abîme d’iniquités, de mensonges, de trahisons ». Il ne devrait pas s’en attrister : ce métier, justement, c’est une mine d’or à ciel ouvert, pour un romancier.
Les Heures pâles
Intervalles
17 euros, 176 pages





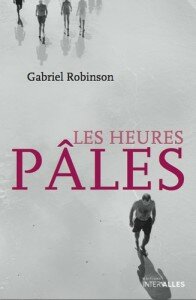





 TUMBLR
TUMBLR
