Il n’y a pas de vrai Andy Kaufman
Métaphysique anarchiste de la télévision américaine, Andy Kaufman (1949-1984) fit du bouddhisme une arme cathodique et pratiquait le sabotage jusqu’à faire douter le public de sa propre existence. Analyse passionnée de spectacles toujours invisibles en France.
Ce qu’Andy Kaufman n’est pas
Andy Kaufman n’est pas un comique. Il prétend n’avoir jamais réussi à raconter une histoire drôle de sa vie et c’est probablement vrai. Il a toujours détesté les blagues, l’ironie, les traits d’esprit et la connivence avec le public. Aucun discours politique explicite, aucune allusion grivoise dans toute son œuvre – à la différence de la plupart des stand-up comics, dont la complicité avec la foule vient des remarques assassines ou des copulations verbales. Kaufman est le roi du mindfuck : une machine à vous détruire la tête, toujours présentée avec un sourire mielleux et une voix doucereuse de fanatique extasié. Vous vous croyez d’un côté du miroir, et vous êtes déjà de l’autre.
En France, jusqu’à ce que Milos Forman réalise Man on the Moon en 1999, nous ignorions jusqu’au nom d’Andy Kaufman. Mais son biopic – accessoirement un des plus beaux films des dix dernières années – n’a malheureusement pas entraîné le dépoussiérage escompté. Aucun de ses sketchs n’a été diffusé en France : ni le Andy’s Funhouse de 1977, ni le Live at the Carnegie Hall de 1979, ni même le monstrueux Andy Kaufman Show de 1982. Trois monuments introuvables aujourd’hui, même en anglais, et dont seuls les extraits sont visibles sur Internet. C’est dommage, parce qu’aujourd’hui que nous assistons aux derniers jours de la télévision comme medium privilégié de la manipulation et de la domination des foules, il serait loisible de se replonger dans l’œuvre d’un des plus grands artistes du genre, dispensateur d’une anarchie métaphysique si radicale qu’elle déborde systématiquement des limites habituellement assignées à la subversion idéologique ou politique.
Il n’y a pas plus dangereux qu’un homme qui ne croit pas à la réalité de sa propre existence.
Ce qu’Andy Kaufman n’a pas fait
C’est très difficile de dire ce qu’à fait Andy Kaufman. Son premier show, Andy’s Funhouse, est déjà d’une étrangeté extraordinaire : dès le prégénérique, Foreign Man (venu d’une île imaginaire de la mer Caspienne) explique devant un décor vide qu’il n’y aura pas de spectacle parce qu’il a dépensé l’argent de la chaîne en se payant des vacances. Maladroitement, « L’Etranger » s’excuse. Il nous conseille de changer de chaîne, se tait et attend longtemps… Si longtemps qu’on devrait déjà avoir éteint… quand il nous rattrape et nous explique qu’il a dit ça pour « faire fuir tous les idiots qui ne comprendraient pas » et que « maintenant que nous sommes seulement entre nous, nous pouvons commencer ». Le générique est lancé et on continue avec lui, planté devant un décor d’une abyssale pauvreté, enchaînant les blagues ratées et les imitations lamentables (la voix de l’imité est filtrée par l’accent de l’imitateur)… jusqu’à celle d’Elvis que Kaufman parfait désastreusement au-delà de toute espérance. Deuxième masque : celui de « Oncle Andy », dans le format conventionnel du talk show, avec des interviews qui pataugent, des sketchs qui ne vont nulle part, des petites chansons malingres et, cerise sur le gâteau, des sautes d’images et un passage de neige télévisuelle… Selon une source, ce serait cette neige et les sautes d’images qui le firent refuser par la chaîne (pour finalement le diffuser deux ans plus tard, lorsqu’il devint célèbre grâce au sitcom Taxi). Selon une autre, c’est qu’on ne savait pas « qui était le vrai Andy Kaufman dans tout ça ». Et c’est vrai que l’animateur y est alternativement gentil, agressif, méprisant, délicieux, humiliant, bête ou d’une vivacité telle que personne ne peut le suivre, transformant la perception du spectateur à son sujet.
Ce que Kaufman démontre magistralement dans son Funhouse, c’est l’angoisse du public dans l’impossibilité d’avoir accès à l’« identité profonde » d’une personnalité publique figurée par sa batterie d’opinions et le simulacre de ses manies. Une star ment plus que la moyenne des gens, mais elle fait semblant de dire la vérité encore plus souvent en multipliant les déclarations. Kaufman, en se refusant à mentir (ou en ne faisant que ça, mais de manière si ostensible que cela annule le mensonge), dérobe le simulacre au spectateur qui se retrouve seul, devant l’écran vide d’un téléviseur qui ne répond plus. Le show opère comme un miroir, et confronte le téléspectateur à la vanité de son désir, qu’il délègue temporairement à la star ou au médiateur contemplé…
La cible principale de toutes les performances kaufmanienne, c’est la notoriété, soit le « rêve américain » lui-même. Un fantasme que tous ses spectacles – mettant l’accent sur le ratage de tout – défont ; le plus cruel étant le Has Been Corner, une séquence où un has been évoque publiquement le moment de sa vie où il a failli devenir célèbre avant de passer à côté de son destin. Et Kaufman, passant de la mièvrerie à une méchanceté excitée, en rajoute pour l’humilier : «… Et maintenant, vous revenez sur scène après tant d’années. On vous souhaite de réussir cette fois-ci (personnellement, je ne crois pas que vous allez y arriver, mais bon, on vous le souhaite quand même…). » C’est un climax d’une obscénité radicale, où le public en vient à haïr ce mielleux présentateur qui le confronte à la triste réalité d’un rêve qu’il partage avec l’invité : la célébrité. Jusqu’au moment où on en vient à se demander si cet invité a jamais existé ! Et les recherches se révéleront si infructueuses qu’on en viendra nécessairement à se demander ce qui peut bien être vrai ou faux dans ce que Kaufman nous montre.
Andy Kaufman a défait tous les principes du showbusiness par un hyperconformisme plus cruel que tout anticonformisme…
Ce qu’Andy Kaufman a défait
C’est très difficile de dire ce qu’Andy Kaufman a fait ; ce qu’on peut dire, c’est ce qu’il a défait. A savoir tous les principes du show-business, un à un, par un hyperconformisme plus cruel que tout anticonformisme, une littéralité plus dissipatrice et plus destructrice que toute allégorie, et un pseudo-amateurisme qui relève de la précision architecturale la plus démoniaque. Après une succession d’invités, dont la grâce tient, donc, paradoxalement à leur amateurisme, et la projection d’un obscur court-métrage des années 30, Mary Ann, où des cow-boys chantent pendant que des cow-girls dansent en levant la jambe, Andy invite « la dernière survivante » de celui-ci, une vieille dame de plus de 70 ans nommé Eleonor Cody Gould dont personne n’a jamais entendu parler et à qui Kaufman demande, avec une politesse obligeante quasi-asiatique, de refaire son numéro de jambe en l’air. Alors que Kaufman fait progressivement accélérer l’orchestre qui accompagne sa danse, Eleonor succombe à une crise cardiaque. Pas de doute : Kaufman est allé trop loin cette fois. Le showman part brusquement, et le producteur du spectacle déboule sur scène, suant d’effroi. Les derniers rires s’étranglent quand il fait rallumer la salle et appelle un médecin qui surgit du public pour confirmer la mort de la danseuse. Silence interminable. Puis Kaufman revient sur la scène, avec un chapeau d’Indien sur la tête… Il fait une ghost dance autour du corps de la vieille dame devant l’audience traumatisée, et Mme Gould se relève… Elle revient d’entre les morts pour saluer la salle… Et c’est comme ça toute la soirée, de numéro en numéro, dissipant une illusion pour la remplacer par une autre, donnant l’impression d’une improvisation continuelle quand il s’agit, en réalité, d’une technique hyper-précise visant à défaire, un à un, tous les leurres suspendus dans l’atmosphère. De minute en minute, ce que nous appelons réalité s’effondre un peu plus sous les coups de burin que le sculpteur Kaufman enfonce dans le plâtre de notre perception.
Le « Vrai Andy Kaufman »
Andy Kaufman est un bouddhiste offensif, un maître de l’illusion sans délivrance. Ce qu’il n’a cessé d’accomplir, dans sa très courte carrière – avant de mourir d’un cancer des poumons à 37 ans (la dernière blague de quelqu’un qui ne fumait pas, ne buvait pas et ne mangeait pas de viande) – c’est de plonger ses spectateurs dans un état de torpeur, un poids de mille atmosphères et une mélancolie saturée d’interrogations. Où s’arrête le show business et où commence le monde réel ? Quels événements révèlent le « vrai Andy Kaufman » ? Ses scandales célèbres dont on n’arrive pas à découvrir s’ils sont le fruit de son impulsivité ou une stratégie savamment orchestré ? Le sketch médiocre que Kaufman s’arrête soudain d’interpréter dans l’émission Fridays – avant de sauter à la figure de son partenaire ? Le mea culpa qu’il prononcera ensuite, accompagné de la chanteuse Kathie Sullivan qui annonce leur mariage et la foi retrouvée d’Andy avant d’entonner une déchirante ballade de christian reborn ?…
En vérité, il n’y a pas de vrai Andy Kaufman. Car, s’il a tant de facilité à nous faire croire aux subjectivités de ses personnages successifs, c’est parce qu’il a une conscience très nette de l’illusion de sa personnalité. Et c’est cette absence de moi patente qu’aucun n’a supporté de son vivant et qui explique ses exclusions successives et ses scandales. Le stand-up comic a tous les droits : provocation, transgression, colère, vulgarité, mauvais goût – mais pas celui de ne pas croire en lui (ce qui veut dire, par ricochet, ne pas croire non plus dans la subjectivité de son spectateur ni dans la réalité du monde). C’est autour de cet interdit que Kaufman tourne dans tous ses sketchs comme un chat qui demande à son maître de lui donner à manger. On comprend dès lors l’usage très particulier qu’il fit de la méditation transcendantale pratiquée sous les auspices du douteux Maharishi Mahesh Yogi, enfarineur notoire des Beatles, des Beach Boys, de David Lynch et auteur légendaire de La Science de l’Etre (le gourou est mort au moment même où je rédige ces lignes ; guerre à ses cendres !) : une organisation dont Kaufman eut le privilège de se faire exclure parce qu’il en donnait une mauvaise image publique.
A la différence des hippies, Andy Kaufman a transformé le bouddhisme en arme. Il a perçu la puissance destructrice de sa technique, et la possibilité de suspendre le monde visible par de simples gestes chargés de toute la force de l’illusion se révélant à elle-même. Il n’y a pas plus dangereux qu’un homme qui ne croit pas à la réalité de sa propre existence. Cette violence, canalisée par les yogis, Kaufman la déchaîne à la télévision comme un apprenti sorcier. Il transforme une pratique de sagesse en son contraire : un exercice de folie décapante. Nous laisserons au lecteur le soin de décider si ce danger est plus grand que celui d’accepter sagement la marche du monde, et si notre Terre a besoin de davantage de saints que de sorciers. Pour notre part, nous remercions Andy Kaufman d’avoir plus d’une fois fait imploser l’écran comme on soulève le voile de Maya, éclairant soudain l’illusion qui sous-tend l’ordre du monde, nous laissant voir la beauté qui n’apparaît que sur ses ruines.
Par Pacôme Thiellement dans Standard n°19
A lire : Andy Kaufman Revealed! de Bob Zmuda (Little Brown and Compagny, 1999) et Andy Kaufman: Wrestling With the American Dream de Florian Keller (University of Minnesota Press, 2005).

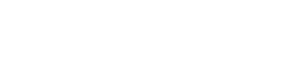






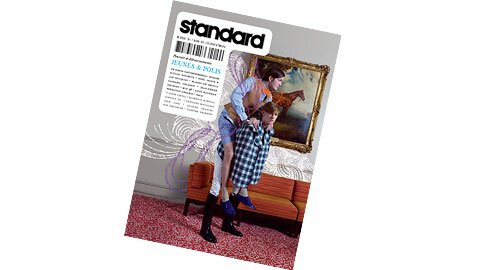


 TUMBLR
TUMBLR
